SCÈNE D’HIVER EN RUSSIE
BERNARD-ÉDOUARD SWEBACH
Paris 1800 – 1870 Versailles
Papier, plume et encre
17,5 × 21,5 cm / 6,9 × 8,5 pouces ; avec cadre 27,5 × 32,5 cm / 10,8 × 12,8 pouces
PROVENANCE
France, collection particulière
La fin des guerres napoléoniennes en 1814 constitua non seulement un événement politique et militaire de premier ordre, mais aussi un tournant dans la vie culturelle de la Russie. Parmi les nombreux artistes et figures culturelles qui retournèrent en Russie ou y arrivèrent à cette époque, on compte plusieurs Français notables qui laissèrent une empreinte durable sur l’art russe du début du XIXᵉ siècle. Parmi eux figuraient le père et le fils Swebach — Jacques François Joseph Swebach-Desfontaines et Bernard-Édouard Swebach.
Jacques François Joseph Swebach-Desfontaines, né à Metz en 1769, reçut une solide formation académique et acquit une renommée comme maître des scènes de bataille, de la peinture de genre et de la lithographie. Ses œuvres se distinguaient par un dynamisme exceptionnel et une précision remarquable, ce qui fit de lui l’un des artistes les plus en vue de son temps. Officiellement invité en Russie pour diriger la Manufacture impériale de porcelaine de Saint-Pétersbourg, Swebach élargit bientôt sa présence et son influence. Cela fut largement rendu possible grâce au mécénat du prince Nikolaï Borissovitch Youssoupov — l’un des aristocrates les plus puissants et culturellement influents de Moscou. À la cour des Youssoupov, les Swebach travaillèrent à de nombreux projets artistiques et se rendaient fréquemment dans le domaine moscovite du prince, Arkhangelskoïe. Ce lien explique leurs déplacements constants entre Saint-Pétersbourg et Moscou et offre un aperçu de leur vie quotidienne et de leur travail créatif.
Le plus jeune, Bernard-Édouard Swebach, fils de l’artiste, reçut une formation approfondie à Paris, dès 1814, lorsqu’il étudia à l’École des Beaux-Arts et travailla sous la direction de son père. Son style s’éloigna progressivement des conventions classiques pour acquérir les traits du romantisme — un mouvement alors naissant dans les cercles artistiques européens. C’est précisément ce regard romantique, associé à une attention portée à la vie populaire et à une observation minutieuse, qui rend ses œuvres uniques.
Il est tentant de suggérer que cette période — leur séjour en Russie et leurs liens étroits avec les Youssoupov — correspond au dessin intrigant de notre collection. Le dessin représente une scène animée de la vie russe : un homme patinant, un paysan portant un joug, et un groupe de militaires et de civils dévalant une colline en traîneau. La vivacité et l’immédiateté de la composition suggèrent que l’œuvre fut exécutée d’après nature, au cœur même de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, où l’artiste séjournait avec son père. Les détails du paysage, l’architecture et même les poses dynamiques des figures donnent à penser qu’avec un peu de persévérance, le lieu exact — le domaine représenté en arrière-plan — pourrait être identifié.
Cette scène n’est pas seulement une représentation de la vie quotidienne ; elle constitue un témoignage d’échanges culturels et un dialogue vivant entre les artistes d’Europe occidentale et la réalité russe. À une époque où la Russie commençait à s’ouvrir plus activement au monde, les œuvres de Bernard-Édouard comptent parmi les premières réponses artistiques à cette nouvelle réalité, alliant technique européenne et couleur locale russe.
Bernard-Édouard Swebach ne se contenta pas de prolonger les traditions de son père : il les imprégna de l’esprit neuf de la poésie romantique propre à son époque. Ses lithographies et ses dessins ne sont pas de simples chroniques visuelles de leur temps, mais des portraits émotionnels de la vie populaire, pleins de dynamisme et d’humanité. D’un point de vue historico-artistique, ce dessin est un document précieux, reflétant non seulement la maîtrise de l’artiste, mais aussi les processus culturels complexes à l’œuvre dans la Russie du début du XIXᵉ siècle.
Ainsi, à travers le destin des Swebach, on peut retracer une histoire fascinante d’échanges culturels, de contribution d’artistes français au développement de l’école russe, et de la manière dont les liens personnels, le mécénat aristocratique et l’amour de la nature se sont conjugués pour créer des chefs-d’œuvre qui continuent de vivre aujourd’hui.
























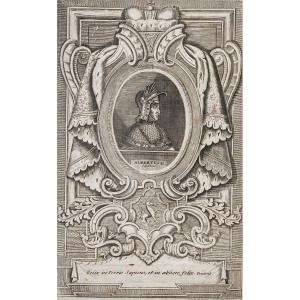





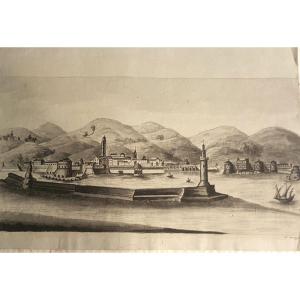






 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato