Vue du Capitole
Huile sur panneau, cm 22 x 32
Dans cette vue du Capitole, nous retrouvons les traits caractéristiques de la tradition verrière italienne, qui s’est développée au cours du XVIIIe siècle comme une continuation du paysagisme qui avait déjà caractérisé l’art baroque au siècle précédent. Une première distinction, par rapport aux exemples précédents, est une prédilection pour la reprise exacte et objective du sujet, en opposition avec les caprices architecturaux et les paysages de fantaisie qui, tout en restant dans la production artistique du XVIIIe siècle, avaient eu plus de chance auprès des artistes de l’époque baroque. L’attention portée aux détails se remarque de manière plus évidente dans les vues urbaines comme celle qui est prise en considération ici, où on note une coupure calibrée de la perspective de la place, de l’escalier et des bâtiments périphériques, Sans négliger aucun détail et sans aucune similitude dans les détails architecturaux. Les lieux emblématiques des grandes villes d’art italiennes, comme Venise, Florence et, justement, Rome, ont été parmi les sujets préférés par les peintres de ce genre, parmi lesquels on peut citer l’auteur de cette table : Salvatore Colonnelli Sciarra, actif à Rome dans la première moitié du XVIIIe siècle. Nous savons peu de choses sur la biographie de cet artiste, peintre et restaurateur romain connu pour sa spécialisation dans la peinture de paysage et pour son rôle dans la récupération d’importantes œuvres d’art à travers ses dessins. Son perfectionnement dans le cadre du vedutismo l’a placé dans un contexte artistique dominé par des figures comme Giovanni Paolo Panini, dont il a été considéré à tort comme un simple disciple par certains historiens, et Antonio Joli, malgré ses œuvres, montrent une qualité et un style distinctifs qui l’élèvent au-delà du rôle d’un simple imitateur. Ses vues, comme cette Vue du Capitole, celle de la Villa Sacchetti ou encore la Vue de la Place du Panthéon, démontrent une remarquable habileté à saisir les détails architecturaux et l’atmosphère urbaine de la Rome du XVIIIe siècle. Sa peinture se caractérise par une utilisation judicieuse de la lumière, qui met en évidence les volumes des bâtiments et crée de la profondeur. Les atmosphères sont souvent claires et limpides, avec un ciel bleu qui contraste avec la couleur terreuse des ruines. Les figures humaines, bien que petites, sont vitales et animent les scènes, ajoutant un sens du mouvement et de la vie quotidienne. L’artiste démontre également une connaissance approfondie de l’architecture classique : chaque détail, des colonnes aux chapiteaux en passant par les façades, est reproduit avec une précision presque scientifique, caractéristique qui le consacra également comme un important documentariste de l’aspect urbain de Rome au XVIIIe siècle.
Colonels Sciarra se révéla non seulement un vedutista de très haute qualité, mais aussi l’habile auteur d’aménagements éphémères et de dessins qui se révélèrent être (et le sont encore) un témoignage historique et artistique très important des biens présents à l’époque, comme ceux pour la décoration de la Salle des Paysages à l’intérieur de la Galerie Colonna, réalisés vers 1730. Les aquarelles avec des vues sur les salles du bâtiment ont été étonnamment découvertes par la chercheuse Maria Chiara Paoluzzi dans une boîte intitulée "Anonymous Roman Drawings" du Windsor Castle, collection de la reine Elizabeth II : la date de 1730, dans la série de feuilles situait avec exactitude la disposition de la quadrerie avec celle de Fabrizio Colonna (1700-1755), fils de Philippe II et d’Olympie Pamphilj.






















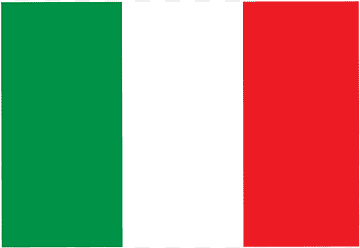 Vedi questo oggetto sul sito italiano
Vedi questo oggetto sul sito italiano





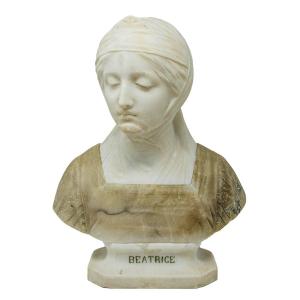

















 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato