Argent fin de France (~960/1000)
Modèle à pied rond, à six contours moulurés de filets
Orfèvre Johann Jakob Dulliker (1731-1810), actif de 1760 à 1800
Berne, vers 1760-1780
1er flambeau:
• Ht totale: ~22 cm
• Diamètre base: ~15,2 cm
• Poids: 291 g
2e flambeau:
• Ht totale: ~21,5 cm
• Diamètre base: ~15,2 cm
• Poids: 266 g
-----
Très bon état général. Micro-chocs et rayures d'usage.
Sans bobèches (si la plupart des flambeaux trompette publiés sont munis de bobèches, on ne sait que très rarement si celles-ci sont contemporaines des flambeaux ou non. D'après ce que nous avons pu constater, de nombreuses bobèches ne sont pas poinçonnées ou, si elles sont bien du XVIIIe, viennent souvent d'un autre atelier. D'ailleurs, la forme très évasée et en légère cuvette du pied des flambeaux trompette se prête parfaitement à une utilisation sans bobèche, comme c'était très souvent le cas au XVIIIe siècle. Voir par exemple le tableau Le Canard blanc (1753) de Jean-Baptiste Oudry, reproduit dans Helft 1980, p.370, où le très beau flambeau d'Antoine Bailly est dépourvu de bobèche).
-----
Bien poinçonnés sous les bases:
• Poinçon de Johann Jakob Dulliker (IID) [König-von Dach, n°31 p.449];
• Poinçon de ville (écu aux armoiries de Berne) [König-von Dach, n°XXI p.447 pour le 1er, n°XXIV p.447 pour le second];
• Poinçon de titre (F couronné) pour titre de France [König-von Dach, n°46 p.449 et p.431 note 572 pour la discussion sur ce poinçon].
-----
Ces flambeaux constituent une fausse paire [0,5 mm et 25 g de différence de hauteur et de poids; le plus grand étant vraisemblablement légèrement plus ancien (vers 1760), si l'on en juge par le poinçon de ville]; cependant, la marque de famille gravée sous les deux flambeaux [ABF] indique un appariement déjà ancien (fin XIXe - début XXe), aussi les proposons-nous ensemble.
-----
Le flambeau trompette (l'appellation flambeau à trompette est attestée dès 1781) tire son nom de la forme particulière de son pied. Il est enrichi à mi-hauteur, pour seul décor, d'un noeud serti de flammes.
Il s'agit d'un modèle spécifiquement suisse: les premiers exemplaires, peut-être inspirés de modèles en cuivre anglais, ont sans doute été exécutés à Vevey par Etienne-Marc Giscard, reçu maître en 1732. Le premier flambeau connu avec datation précise est attesté en 1753 (commande de la corporation bernoise Zu Pfistern à l'orfèvre Johannes Hug).
Si les premiers modèles présentent des pieds octogonaux, le pied rond - délicatement contourné et mouluré de filets, comme sur nos exemplaires - va vite s'imposer comme le pied "classique", sans doute sous l'impulsion de l'orfèvre lausannois Philibert Potin [Hörack 2007, p.113 sqq.].
Le flambeau trompette est sans conteste l'objet d'orfèvrerie le plus fabriqué à Lausanne dans les années 1750-1780. Johann Jakob Dulliker est un des rares orfèvres bernois, avec Johannes Hug, à les avoir produits au XVIIIe siècle. On en retrouve aussi à Vevey, à Lenzburg, à Aarau, à Bâle, à Fribourg et à Neuchâtel, mais ils y sont peu nombreux [Hörack 2007, p.114]. Nous connaissons une paire de flambeaux trompette au poinçon de Sion, fabriqués par l'orfèvre François-Joseph Ryss (actif de 1759 à 1802), actuellement dans une collection particulière valaisanne.
------
Littérature
• Charlotte König-von Dach, R&C, Die Goldschmiedewerkstatt Rehfues in Bern 1808-1866, Galerie Stuker, Bern 1993
• Christian Hörack, L'argenterie lausannoise des XVIIIe et XIXe siècles, Musée historique de Lausanne, 2007




































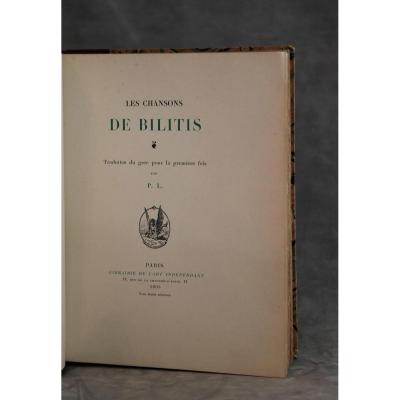













 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato