Le parcours, d'une rare fascination et d'une grande complexité culturelle, de Francesco Laurana, le célèbre sculpteur dalmate né dans l'actuelle Vrana (Aurana) près de Zadar – un bourg de Dalmatie relevant de la domination vénitienne au XVe siècle –, est également attesté par ce buste inédit et captivant de jeune homme (fig. 1-4). Caractérisé par des volumes arrondis et des traits essentiels sculptés avec une légèreté particulière et une intention fortement abstraite, ce buste révèle les traits stylistiques propres au sculpteur. Laurana a en effet su concilier, notamment dans ses portraits féminins sculptés lors de son second séjour napolitain – le plus fécond de sa carrière de portraitiste –, une synthèse formelle rappelant celle d'Antonello da Messina et de Piero della Francesca dans ses bustes représentant les princesses aragonaises.
L'activité de portraitiste fut précisément celle qui qualifia l'œuvre du sculpteur, jouant un rôle majeur dans la diffusion de la culture figurative de la Renaissance, comme en témoigne son parcours biographique : actif dès le milieu du XVe siècle à la cour aragonaise de Naples, où il est documenté pour la première fois en 1453 en tant que "Francisco da Zara" et reçoit, avec d'autres maîtres, le paiement pour les travaux de l'Arc de Triomphe de Castelnuovo, il se rendit ensuite, en 1466, en Provence, au service de René d'Anjou. Après un second séjour napolitain, il fut actif en Sicile, puis de nouveau à la cour aragonaise, avant de s'établir à Marseille et Avignon, où il mourut.
Le buste-portrait florentin et son influenceLes bustes-portraits, généralement coupés juste en dessous des épaules, comme l'exemplaire étudié ici, constituent un genre représentatif du Quattrocento florentin. Les sculpteurs qui contribuèrent le plus à son développement furent Donatello, Mino da Fiesole, Desiderio da Settignano, Antonio Rossellino et Benedetto da Maiano. Leur fonction était de légitimer la noblesse de l'époque et, pour cette raison, ces œuvres étaient commandées en particulier par les familles aristocratiques et la haute bourgeoisie marchande. À Florence, ville d'où ce genre se diffusa dans les cours italiennes, sa redécouverte par les artistes susmentionnés reposait sur la récupération de la culture classique promue par les humanistes, la redécouverte de la valeur de l'individualité de l'homme et l'étude des bustes romains placés dans la 'domus' pour commémorer les vertus des défunts. Pour ces raisons, ces œuvres se distinguent par l'extrême réalisme des physionomies et une introspection psychologique aiguë. En témoignent des œuvres comme le buste en terre cuite peinte de l'humaniste Niccolò da Uzzano au Museo Nazionale del Bargello de Florence, autrefois attribué à Donatello et aujourd'hui à Desiderio da Settignano ; le portrait de Piero de' Medici (1453) sculpté par Mino da Fiesole, également au Bargello ; celui du médecin Giovanni Chellini (1456) par Antonio Rossellino au Victoria and Albert Museum de Londres ; et celui du marchand florentin Pietro Mellini, allié des Médicis, exécuté par Benedetto da Maiano, également au Bargello.
Analyse du buste de Laurana et sa singularitéC'est au sein de cette culture figurative qu'il convient d'étudier, pour en apprécier les qualités, notre buste (fig. 1-4). Il représente probablement un jeune homme de la cour aragonaise, élégamment vêtu à la mode d'une tunique de velours à larges revers, rehaussée d'un col, et se trouve en bon état de conservation (la surface du marbre est par endroits légèrement délavée).Le visage ovale, tendre, doux et noble de ce jeune homme à l'expression éthérée, caractérisé par des arcades sourcilières d'où les yeux fixes renvoient une expressivité presque imperturbable, est défini par des traits essentiels, des formes lisses et arrondies : les paupières fines confèrent au regard une expression de puissante introspection. Une chevelure vaporeuse, élégante et fluide, caractérisée sur le front bombé par une mèche proéminente, descend juste au-dessus des épaules, donnant, même de profil, le sens d'une calotte douce (fig. 2,3). La représentation précise du personnage, restituant un caractère et les vêtements, comme la souple giornea de velours à cannelures qui met en évidence la structure élancée et encore gracile du corps, sur laquelle se détachent avec une détermination calibrée les plis du drapé, sont des aspects qui incitent à le considérer comme le portrait d'un membre de la cour aragonaise ou de l'aristocratie napolitaine.
En observant également notre jeune homme, nous pouvons comprendre la place occupée par Laurana dans l'élaboration du genre des bustes-portraits au cours du XVe siècle. Le sculpteur dalmate, en effet, bien que reprenant la typologie élaborée par les sculpteurs florentins, se place aux antipodes du naturalisme donatellien, restituant les traits de l'effigié par une nette idéalisation hiératique des formes. Cette particularité est également visible dans cette œuvre : la pureté presque abstraite du visage, les volumes à la solide structure compositionnelle (on observera également les vues de profil : fig. 3,4) qui semblent figés dans leur pureté géométrique. Ce sont des spécificités qui, associées à l'attention portée aux détails vestimentaires tirés de la mode contemporaine (la forme du vêtement et de la coiffure), qualifient l'expressivité portraitiste de Laurana à travers deux aspects contrastants qui renferment, dans leur combinaison, le charme de telles œuvres.
Le succès et l'influence de LauranaC'est probablement cette particularité qui a assuré le succès de la production portraitiste de Laurana auprès des cours italiennes et européennes du XVe siècle : une spécificité expressive dans l'élaboration de laquelle l'environnement artistique animé de la cour napolitaine joua un rôle décisif. Grâce au séjour d'artistes venus de toute l'Italie, des éléments stylistiques de la sculpture lombarde, des éléments picturaux de l'art franco-flamand et florentin y convergèrent, lesquels devinrent des modèles dans le portrait italien contemporain. Ainsi, chez notre jeune homme, un degré marqué de réalisme (la ressemblance avec le modèle), obtenu par un modelé précis des surfaces avec une prédilection pour les formes douces (comme dans la bouche aux lèvres charnues et prononcées) et une structure volumétrique solide et proportionnée dérivée du portrait romain, se combine, dans un buste-portrait à l'aspect rigoureusement frontal, avec une forte tendance à l'idéalisation exprimée dans la restitution des traits introspectifs (on observera l'entaille des yeux) avec une clarté incisive que Laurana obtient toujours dans ses œuvres en marbre.
La koinè figurative commune à laquelle appartiennent certains sculpteurs actifs en Italie méridionale, comme Laurana et le Lombard Domenico Gagini, a conduit la critique à des divergences concernant le catalogue de ces artistes, qui s'est souvent entremêlé, attribuant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, certaines œuvres. Il est cependant possible d'établir des comparaisons pertinentes entre notre buste et certains portraits en marbre attribués au sculpteur.
Un buste de jeune homme au Musée Calvet d'Avignon (fig. 7), aux traits doux et réguliers, avec des yeux très fins, est unanimement attribué à Laurana par la critique. Récemment, un Saint Quirico (fig. 6) en buste au Paul Getty Museum de Malibu a été attribué à Laurana. Un buste de jeune homme (fig. 9) à la Galleria Nazionale de Palerme est discuté entre notre sculpteur et Domenico Gagini ; une situation similaire a concerné un buste de jeune homme (fig. 11) à la Ca' d'Oro de Venise, peut-être représentant Federico Gonzaga, attribué par Middeldorf à Laurana et récemment à Gian Cristoforo Romano. Avec ces œuvres, notre buste partage le modelé calme de l'image, le rendu volumétrique plastique et ferme, l'implantation ovoïde du visage, la politesse et l'extrême délicatesse des traits inclinés vers l'abstraction formelle.
Laurana est de nouveau présent à Naples au début des années quatre-vingt. C'est à ce moment chronologique que nous proposons de rattacher notre buste, sophistiqué dans son degré de raffinement formel, où convergent les traces de sa vaste expérience figurative : une œuvre dans laquelle nous identifions cette sensibilité expressive si moderne, en équilibre entre caractérisation individuelle et abstraction, qui constitue la qualité singulière du portrait lauranien.








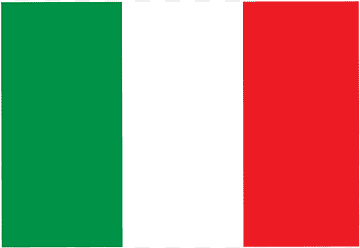 Vedi questo oggetto sul sito italiano
Vedi questo oggetto sul sito italiano























 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato