Paul-Louis
MARTIN des AMOIGNES
(Saint
Benin d’Azy 1850 – Nevers 1925)
Les
bohémiens
Huile
sur panneau
H.
37 cm ; L. 23 cm
Monogrammée en bas à gauche « PLM »
Circa
1886
Provenance : Collection privée, Bordeaux
Œuvre en rapport : Œuvre finale, 141 x 97 cm, passée aux enchères à Bordeaux à l’hiver 2024/25.
Paul
Louis Martin des Amoignes (1850–1925) demeure une figure marquante
de la peinture régionale française à la croisée des XIXe et XXe
siècles. Né à Saint-Benin-d’Azy, dans la Nièvre, il appartient
à cette génération d’artisans devenus artistes, dont le parcours
est façonné par le labeur, les soutiens locaux et une volonté
tenace. Formé initialement comme peintre en voitures, il se détourne
peu à peu de l’artisanat pour se consacrer à la peinture
d’art.
Son entrée dans le monde des beaux-arts se fait
grâce à la bienveillance du peintre Hector Hanoteau, qui
l’accueille dans son atelier parisien, ainsi qu’au soutien de
l’architecte Bouveault de Monteignier. C’est Hanoteau qui lui
attribue le nom d’artiste “des Amoignes”, en référence à une
région de la Nièvre, afin de lui forger une identité propre dans
un milieu artistique déjà foisonnant.
Son œuvre
s’enracine profondément dans la terre morvandelle : paysages,
scènes de la vie rurale, intérieurs d’églises composent une
production sensible et fidèle à l’esprit naturaliste. Proche dans
sa démarche de peintres comme Jules Bastien-Lepage, Martin des
Amoignes s’attache à restituer avec précision et émotion le
quotidien d’un monde paysan en mutation.
Dès 1881, il
expose régulièrement au Salon des artistes français, où il est
distingué en 1898 pour son tableau “La saison des blés”. Cette
reconnaissance, confirmée en 1900 par son élévation au rang
d’officier d’académie, inscrit son travail dans le paysage
artistique de son temps. Il forme avec son épouse Élisabeth
Wedekind, peintre de fleurs, un couple d’artistes engagé dans la
vie culturelle nivernaise, notamment au sein du Groupe d’émulation
artistique du Nivernais.
À partir de 1903, il s’établit
à Nevers, où il poursuit son œuvre tout en participant activement
à la scène artistique locale. Son art, diffusé jusqu’à
l’étranger, séduit par sa justesse de ton et sa profondeur
d’observation. Le musée de Nevers conserve aujourd’hui plusieurs
de ses toiles emblématiques,
reflets d’un regard attentif à la mémoire des lieux et aux gestes
du quotidien.
Ce
tableau de Martin des Amoignes, réalisé autour de 1886, s’inscrit
pleinement dans le courant naturaliste de la fin du XIXe siècle. Il
représente une femme tirant une roulotte sur un chemin, dans
laquelle se trouvent des enfants. Un chien tenu en laisse accompagne
ce pauvre convoi.
L’œuvre frappe par sa composition
frontale et resserrée, où la figure humaine, en légère plongée,
s’impose au spectateur dans un axe vertical central, encadrée par
la structure sombre de la roulotte. Ce cadrage met en tension la
rudesse du geste et la monumentalité du sujet, tout en valorisant
une iconographie de la marginalité — thème alors en vogue dans la
peinture sociale.
Le traitement pictural, à la brosse
rapide et empâtée, évoque un réalisme rugueux, presque brut, qui
rappelle les recherches des peintres de l’école de Barbizon et de
Jules Bastien-Lepage. Le choix chromatique, dominé par des tons
terreux et des ocres blanchis, contribue à restituer l’aridité du
sol et la poussière ambiante, tandis que le ciel, volontairement
neutre, renforce l’effet d’isolement de la figure.
L’attention
portée à la gestuelle et à la matérialité du vêtement, combinée
à l’arrière-plan réduit à une ligne d’horizon effacée,
concentre le regard sur le labeur du corps et la condition précaire
de la femme représentée. On peut y lire une volonté quasi
ethnographique de documenter un quotidien périphérique, celui des
nomades, des marginaux ou des paysans en transit.
Enfin,
le monogramme “P.L.M.” en bas à gauche fait le lien avec le
tableau final de Martin des Amoignes, dont cette esquisse témoigne
de l’engagement dans une peinture de terrain, attentive aux
réalités sociales de son temps.
















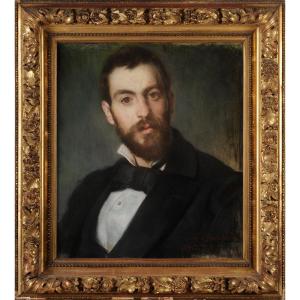





















 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato